Qu’est-ce qui distingue à l’oreille humaine une œuvre musicale d’un autre son ? N’est-il pas intéressant que la musique reste aussi attachée à la notion d’œuvre, là où les arts plastiques digèrent encore la révolution du ready-made, et que les auditeurs soient toujours attentifs à ce qu’ils croient saisir par-delà le son ?
Chacun de nous, musicien ou non, peut se réjouir du son du ressac autant que de celui du concert, y trouver de l’intérêt et du plaisir. Plus encore, nous sommes prédisposés à chercher en tout son sa cause, en particulier une cause qui porterait la marque de l’intelligence, si possible celle de l’humain. A défaut de causes physiques ou techniques identifiables, y compris musicales, l’analyse se réduit d’instinct à l’anthropomorphisme et l’éthologie les plus élémentaires. C’est ce qui se passe lorsqu’on questionne sommairement le chant d’un oiseau : est-ce un langage, utile à la localisation et à la reproduction, propre à disserter du temps qu’il fait ou des états de l’âme aviaire, ou est-ce une production artistique qui, au-delà des parades sexuelles, spécule sur sa propre forme ?
C’est aussi ce qui se passe lorsque nous écoutons de la musique : l’auditeur présuppose sans difficulté la raison derrière le son. Il peut substituer à sa jubilation esthétique, surtout lorsque le beau fait défaut à ses sens, une recherche musicale de la cause, une étiologie du sonore. C’est là un paradoxe du jugement artistique : le déplaisir esthétique est propice à l’introspection et à l’analyse, pour peu qu’on y consente. Je ne dis pas que ceci soit préférable au plaisir d’une œuvre qu’on aime immédiatement (combien d’auditeurs voit-on se précipiter sur le programme d’un concert par désespoir de ne pas apprécier ce qu’ils entendent – ce qui est bien leur droit !), mais qu’il est possible de trouver, par les voies de la raison, les conditions de la réception esthétique d’une œuvre. Nous pouvons mettre une vie entière à apprécier la musique d’un compositeur, sans que cela relève d’un apprentissage ou d’une quelconque « acculturation ».
Le problème ultime de la cause du son advient lorsque sont mis en défaut à la fois notre plaisir esthétique et nos capacités de compréhension. Comme en d’autres domaines, le penchant, hélas majoritaire, de l’humain pour la transcendance le pousse à chercher, non plus la cause, mais le dessein, de sorte que l’étiologie du son se mue en téléologie, c’est-à-dire en la recherche d’un créateur et de ses intentions. Ainsi, l’auditeur, le moins avisé à mon goût, guettera, à travers la musique, qu’elle soit écrite ou jouée, par-delà la sensation et le jugement, la finalité supposée du compositeur ; le signe, derrière le phénomène, d’une intelligence qui l’aurait mis en œuvre.
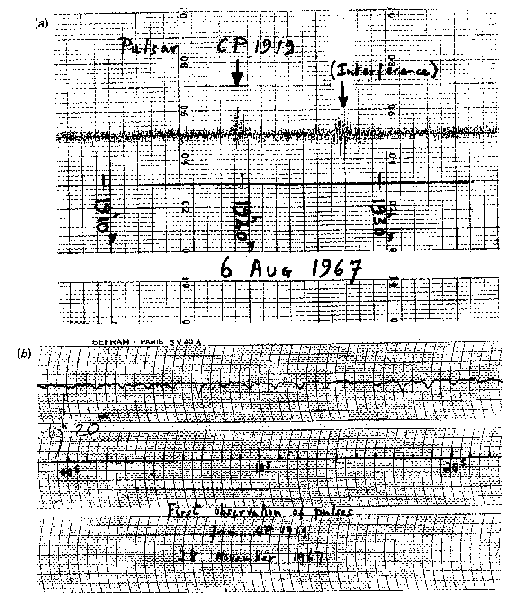
L’histoire récente des sciences offre un avatar très représentatif de cette quête de l’intelligence, cette espérance démesurée que l’espèce place en toute chose, y compris la musique, d’y trouver la trace d’un esprit qui lui ressemble. En 1967, l’astronome Antony Hewish, aujourd’hui prix Nobel de physique, et son étudiante Jocelyn Bell, captent au radiotélescope un signal très singulier : de courtes impulsions répétées régulièrement. Ayant d’abord supposé une origine artificielle, écartant cependant toute interférence ou émission d’origine terrestre, ils baptisent la source du signal « LGM-1 », comprenez Little Green Men – 1. Imaginez, transposée au domaine musical, cette-même anecdote : le compositeur deviendrait un extra-terrestre, créateur distant dont l’auditeur devrait deviner le dessein à la faveur d’un message énigmatique.
En fait de petits hommes verts, ce signal permit la découverte d’un type d’objets célestes, les pulsars, étoiles à neutrons, à la fois plus petites et massives que notre soleil, en rotation rapide, émettant un champ magnétique très intense. La régularité du signal, qui satisfait tant notre désir d’anthropomorphisme, n’est que le résultat du comportement physique de ces objets. En 1990, le compositeur Gérard Grisey fera entendre ces mêmes pulsars dans Le noir de l’étoile, pour six percussionnistes accompagnés du « son » des pulsars, « musique avec pulsar obligé ».
L’anecdote, scientifique et musicale, met en lumière ceci : notre nature nous invite à estimer en chaque phénomène la quantité d’intelligence qu’il aurait fallu pour le produire. Si nous y sommes disposés, nous guettons la marque de l’humain et, comme les sciences de l’information qui qualifient un signal par son entropie et sa complexité, nous distinguons le bruit contingent, auquel nous ne prêtons aucune intelligence, de l’œuvre désirée où nous croyons percevoir l’empreinte de l’esprit – mais nous pouvons jouir de l’un comme de l’autre.
Bien des artistes vous diraient que, puisque tous les sons sont susceptibles d’être appréciés, on ne peut pas différencier le bruit de la musique, pas plus que le son incident de l’œuvre d’art. Dans les arts plastiques particulièrement, où le bouleversement du ready-made de Marcel Duchamp peine à être dépassé depuis un siècle, la méfiance vis-à-vis des notions d’œuvre et d’art conduit à la négation de cette distinction et impose que l’œuvre soit entièrement le fait de son récepteur. A l’inverse, dans la musique, art de l’opus et de l’opéra, les notions de travail et de complexité demeurent, auprès des compositeurs comme des mélomanes. Les raisons en sont nombreuses mais le résultat est là : aucune autre forme d’art n’a aussi bien domestiqué le bruit, et le Marteau sans maître de Pierre Boulez continuera à faire bien plus de bruit que les enfantillages des destructions de pianos à la Fluxus. La musique, même par hasard, peut simuler le bruit et le renoncement à la raison, l’inverse est beaucoup plus difficile.

